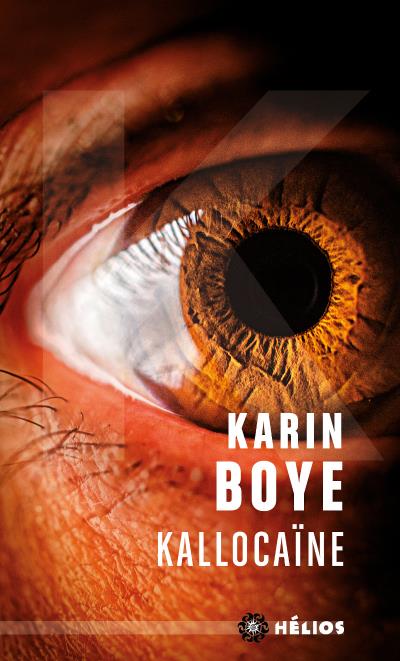 Dans une société où la surveillance de tous, sous l’œil vigilant de la police, est l’affaire de chacun, le chimiste Leo Kall met au point un sérum de vérité qui offre à l’État Mondial l’outil de contrôle total qui lui manquait. En privant l’individu de son dernier jardin secret, la kallocaïne permet de débusquer les rêves de liberté que continuent d’entretenir de rares citoyens. Elle permettra également à son inventeur de surmonter, au prix d’un viol psychique, une crise personnelle qui lui fera remettre en cause nombre de ses certitudes. Et si la mystérieuse cité fondée sur la confiance à laquelle aspirent les derniers résistants n’était pas qu’un rêve ?
Dans une société où la surveillance de tous, sous l’œil vigilant de la police, est l’affaire de chacun, le chimiste Leo Kall met au point un sérum de vérité qui offre à l’État Mondial l’outil de contrôle total qui lui manquait. En privant l’individu de son dernier jardin secret, la kallocaïne permet de débusquer les rêves de liberté que continuent d’entretenir de rares citoyens. Elle permettra également à son inventeur de surmonter, au prix d’un viol psychique, une crise personnelle qui lui fera remettre en cause nombre de ses certitudes. Et si la mystérieuse cité fondée sur la confiance à laquelle aspirent les derniers résistants n’était pas qu’un rêve ?
La Critique de l’Ogre : 8/10
Kallocaïne est un roman suédois du XXe siècle, souvent associé à 1984 d’Orwell ou encore à Le Meilleur des Mondes d’Huxley, comme l’un des fers de lance de la littérature de science-fiction dystopique. Un État Mondial abolissant les individualités au profit de l’intérêt de la nation, des citoyens dédiés corps et âme dont le rythme de vie est orchestré heure après heure par des dirigeants totalitaires… Tout est ici dans la plus grande tradition des dystopies classiques du siècle dernier, dans lesquelles on retrouve souvent des inspirations des régimes ayant laissé leur empreinte dans cette époque. Dans Kallocaïne, le parallèle avec le communisme est sans équivoque, un témoignage de Temps où les projets de société s’opposaient entre grandes nations rivales.
Comme dans nombre d’histoires dystopiques, il y a le contexte, décrit au travers des premières pages, puis, l’événement, l’objet, le concept, qui va soudain changer la donne et faire basculer l’histoire. Ici, c’est la kallocaïne, cette drogue inventée par Leo Kall, espèce de super sérum de vérité, qui va permettre à l’État de s’immiscer dans la dernière forteresse personnelle de ses citoyens : leur esprit. De cette manière, ce n’est plus ceux qui se tournent contre l’État qui seront punis, mais aussi ceux qui se contentent d’avoir des pensées dissidentes. Une perspective terrifiante qui est habillement traitée. Ici, on se place dans la tête de son inventeur qui comprend et découvre, au fur et à mesure de la progression de son projet, les terribles conséquences. Sur fond de complot mystérieux, Leo Kall se confronte à des témoignages qui remettent en cause l’État Mondial et déclenchent chez lui des questionnements intimes qui finiront d’avoir raison de son aveugle fidélité.
C’est ainsi un roman introspectif. On est dans la tête de ce Leo Kall, on découvre avec lui l’impact de son invention, on suit avec lui ses pensées qui dérivent, lentement, aux côtés de la progression de son invention au sein de l’État. Un homme qui perd contact avec ses certitudes, sa dévotion à l’État, qui s’interroge sur sa vie, sa femme, sa relation à lui-même… Et qui réalise que peut-être, la boîte de Pandore a été ouverte. Car la nature de l’homme est de s’interroger, de questionner, de s’adapter… En rentrant dans l’esprit de tout un chacun, comme il est si bien dit dans ce livre : tout le monde peut être condamné. Tout le monde se heurte, un jour, à des doutes. Au-delà de la critique de société, de la dystopie en soi, c’est ce thème central qui tient le livre et qui le rend passionnant !
L’histoire progresse inexorablement vers un dénouement que l’on sait, dès le début du livre, funeste pour le héros. On suit sa descente aux Enfers psychologique avec intérêt, même si je trouve, pour ma part, que l’écriture est un peu trop soutenue à mon goût, pas des plus faciles à suivre, et souvent inutilement adjectivée. Mais c’est passionnant, on s’attache, paradoxalement, à une personne qui présente des points de vue très cliniques sur sa vie et la société, mais c’est en grande partie parce que l’on sait, on voit, on lit, que c’est une sorte de façade, un long mensonge qu’il s’assène à lui-même.
Un très bon roman de science-fiction dystopique qui rend honneur à ce genre.


